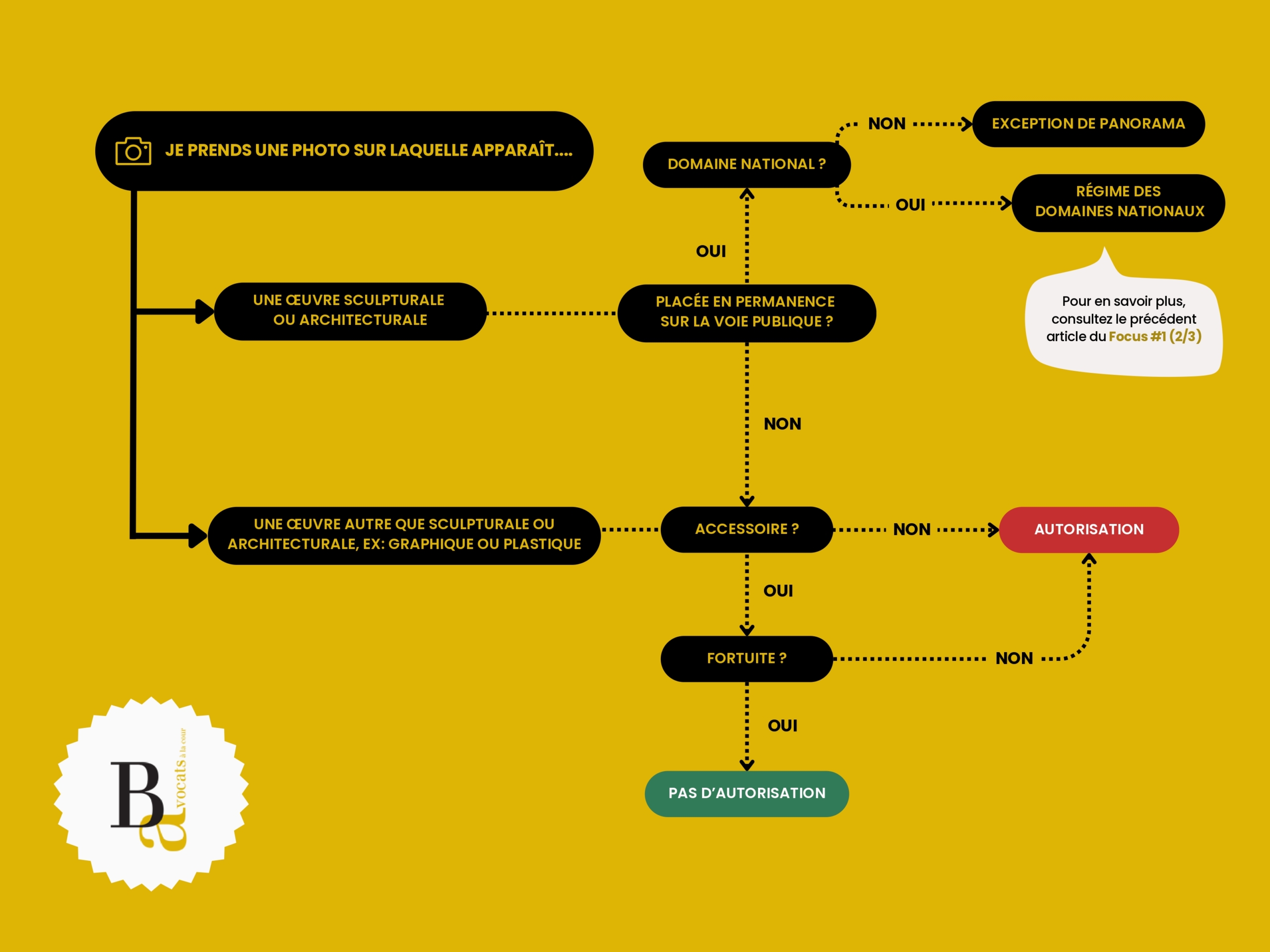Qui n’a jamais rêvé de découvrir un trésor caché entre deux cartons oubliés au fond d’un grenier ou derrière le four ? Parfois, le hasard fait bien les choses : un objet de valeur refait surface lors de travaux, d’un déménagement ou d’un simple rangement. Mais derrière la découverte, des questions se posent : Que faire de cet objet ? A qui appartient-il réellement ? Ce focus vous apportera quelques éléments sur les bonnes questions à se poser dans cette situation.
LA DÉCOUVERTE D’UN TRÉSOR : QUI EN EST PROPRIÉTAIRE ?
Dans le langage courant, un trésor désigne généralement un objet ou un ensemble d’objets de grande valeur, dissimulés ou cachés. Toutefois, le droit en donne une définition plus précise à travers l’article 716, alinéa 2, du Code civil :
« Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. »[1]
👉 Qu’est-ce qu’un trésor ?
- Le trésor est un bien meuble
Un trésor, au sens du Code civil, est nécessairement un bien meuble, c’est-à-dire un objet pouvant être déplacé. Il doit en outre être distinct de son contenant. Cela signifie que le trésor doit pouvoir être extrait du fonds dans lequel il a été trouvé, comme un bijou peut être extrait de sa boîte. C’est cette exigence qui a conduit la jurisprudence à exclure la qualification de trésor dans le cas d’un restaurateur qui, à l’occasion du nettoyage d’une peinture, avait découvert sous la première couche picturale l’œuvre d’un autre peintre, Jean Malouel. [2]
- Le trésor doit avoir été dissimulé
Pour être qualifié de trésor, l’objet doit avoir été dissimulé dans un meuble ou dans un immeuble. Des lingots d’or trouvés sous des gravats [3], cachés dans une cuisinière[4], ou enfouis dans le sol d’un jardin[5] peuvent être qualifiés de trésors.
En revanche, la découverte d’un tableau dans un grenier ne permet pas de considérer qu’il y était caché, « un grenier étant habituellement utilisé pour remiser des objets dont on ne souhaite plus, provisoirement, se servir »[6].
- Le trésor est une chose sur laquelle personne ne peut justifier de sa propriété
Le Code civil donne une définition selon laquelle le trésor est une chose « sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété ».
Le trésor est généralement un bien qui a déjà fait l’objet d’une appropriation, mais dont le propriétaire est inconnu au moment de la découverte. La qualification d’un objet en tant que trésor suppose donc l’impossibilité d’en déterminer le propriétaire.
⚖️ À titre d’exemple, ne sont pas considérés comme trésor cinq lingots d’or, des titres au porteur, un sac de pièces d’or et quelques pièces d’argent découverts par un particulier dans une cuisinière à gaz qu’il venait d’acheter. Dans cette affaire, le vendeur, ayant revendiqué la propriété de ces biens, en avait repris possession, ce qui avait conduit l’acheteur à l’assigner en justice en soutenant que la propriété du trésor appartenait à celui qui le trouvait sur son propre fonds. Toutefois, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel qui avait écarté la qualification de trésor, le vendeur ayant rapporté la preuve qu’il était propriétaire des biens trouvés[7].
Il ne s’agit ni d’une chose sans maître (res nullius), ni d’un bien abandonné (res derelicta) [8], mais bien d’un objet caché, dont l’identité du propriétaire s’est perdue dans le temps [9].
⚖️ Dans l’ancienne affaire du trésor de la rue Mouffetard, lors de la démolition d’un immeuble, plus de 3.000 louis d’or ont été découverts alors qu’ils étaient dissimulés depuis deux siècles. Le Tribunal civil de la Seine a retenu que ces pièces ne constituaient pas un trésor au sens du Code civil dans la mesure où leur propriété était revendiquée par les héritiers de l’ancien propriétaire de l’immeuble, et ce malgré l’ancienneté de la dissimulation[10].
Depuis, la Cour de cassation a nuancé la portée de cette décision et considère que la qualité d’héritier de l’ancien propriétaire de l’immeuble ne suffit pas, à elle seule, pour prétendre à la propriété d’un trésor découvert par un tiers. [11]
⚠️ Notez que dans le cadre de la découverte d’un potentiel trésor, l’action en revendication de la propriété est imprescriptible ! Le propriétaire du bien, s’il apprend sa découverte, aura toujours la possibilité de revendiquer son titre [12].
- L’objet doit avoir été découvert par le pur effet du hasard
La jurisprudence refuse d’attribuer la qualité de « trésor » à un objet qui aurait été découvert lors de fouilles ou de recherches intentionnelles.
📌 A noter : la Cour de cassation apporte une interprétation plutôt stricte de la notion de hasard dans la découverte d’un trésor. Par exemple, une caisse contenant des lingots d’or retrouvée à l’occasion de travaux de déblayement ne constitue pas un trésor. Pourquoi ? Parce que les anciens propriétaires de la maison dans laquelle la caisse a été trouvée avaient averti l’acquéreur du fait que des lingots d’or, qu’ils avaient cherché en vain, pouvaient potentiellement se trouver dans la cave. La découverte ne relevait donc plus du hasard, mais d’une recherche intentionnelle [13].
👉 Qui est propriétaire de l’objet précieux découvert ?
La propriété du trésor dépend des circonstances de sa découverte. En effet, l’article 716 alinéa 1e du Code civil dispose que :
« La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds ».
⚠️ Attention ! l’application de cette règle diffère lorsque le fonds appartient à une personne publique. Dans ce cas, la propriété du trésor revient par moitié à la personne publique propriétaire du domaine sur lequel il a été découvert (Etat, collectivité territoriale, établissement public), et par moitié à la personne qui l’a découvert (aussi appelé « inventeur »).
👉 Quid de l’inventeur ?
L’inventeur ne désigne ici pas le chercheur dans son laboratoire mais celui qui découvre un trésor en le rendant visible. [14]
Comme le rappelle la doctrine, l’inventeur est celui qui a aperçu le trésor en premier, et non celui qui aurait donné le dernier coup de pioche[15]. Si le trésor est découvert par un tiers, il en deviendra l’inventeur. La propriété du trésor sera donc partagée entre l’inventeur, d’une part, et le propriétaire du terrain, d’autre part.
Par ailleurs, si le trésor est découvert par l’employé d’une entreprise (ouvrier présent pour effectuer des travaux par exemple), l’employé sera qualifié d’inventeur et non l’entreprise pour laquelle il travaille. [16]
🥑 Nos conseils
- Recherchez les indices d’une éventuelle propriété.
- Conservez des éléments pouvant relater les circonstances de la découverte – Que vous soyez le propriétaire du terrain ou l’inventeur du trésor, il est primordial de documenter le déroulement de la découverte. Vous pouvez photographier le lieu où a été retrouvé l’objet, ainsi que l’objet lui-même en détail. Cela vous permettra de garder des informations utiles telles que la date, les témoins, la dissimulation de l’objet, et les circonstances de la découverte.
- Chaque situation présente ses propres spécificités, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un avocat pour vous éclairer !
[1] Code civil, art. 716 al. 2
[2] Cass. 1e civ., 5 juillet 2017, n° 16-19.340
[3] CA Rennes, 2 novembre 2022, n° 20/03101
[4] Cass., Civ. 1e, 19 novembre 2002, n°00-22.471
[5] Cass. 1e civ. 6 juin 2018, n°17-16.091
[6] CA Paris,13 janvier 1998, n° 96/06398 : JurisData n° 1998-020069
[7] Cass., Civ. 1e, 19 novembre 2002, n°00-22.471
[8] C. Saujot, Modes d’acquisition de la propriété – trésor, Lexis 370, janvier 2017, para. 7
[9] P. Berchon, A. Béguin, Trésor, Répertoire de Droit Civil, Dalloz, janvier 2024, para. 76
[10] T. civ. Seine, 1e juin 1949, cité dans P. Berchon, A. Béguin, Trésor, Répertoire de Droit Civil, Dalloz, janvier 2024, para. 35
[11] Cass. 1e civ. 25 octobre 1955, cité dans P. Berchon, A. Béguin, Trésor, Répertoire de Droit Civil, Dalloz, janvier 2024, para. 78
[12] Cass. 1e civ. 6 juin 2018, n°17-16.091
[13] Cass. Crim. 21 mars 1978, n° 77-93.108
[14] Cass. 1e civ., 16 juin 2021, n°19-21.567
[15] P. Berchon, A. Béguin, Trésor, Répertoire de Droit Civil, Dalloz, janvier 2024, para. 84
[16] Cass. Crim. 20 novembre 1990, n° 89-80.529